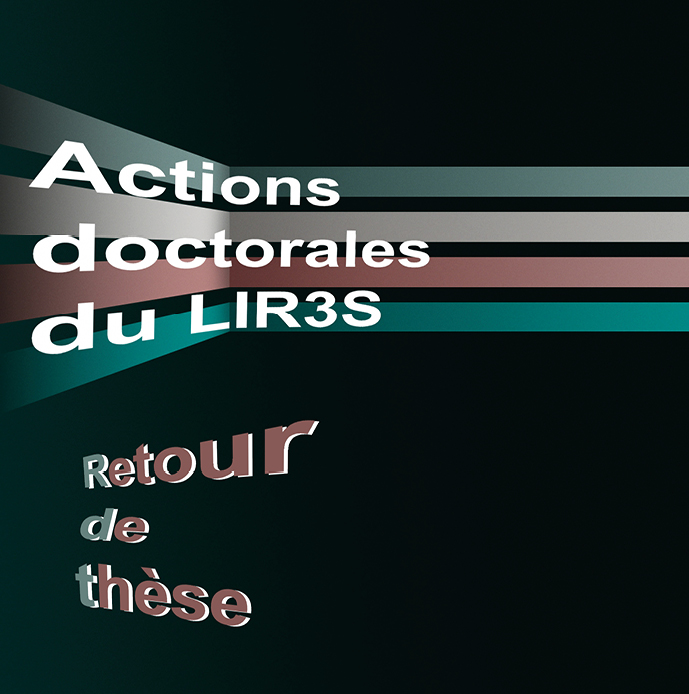Actions doctorales du LIR3S : retour de thèse
Organisation : Isabelle Marinone (LIR3S UMR 7366 CNRS-uB)
Présentation de la séance
- Composée/Décomposée/ Recomposée : la « famille » saisie par le cinéma français à la fin du XXe siècle (1970-1990),
par Lucas Cordier (Doctorant d’histoire contemporaine et histoire du cinéma)
L’exposé réalisé pour cette occasion portera plus particulièrement sur les sources filmiques de ce sujet de thèse et la composition d’un corpus pertinent afin d’étudier le thème sélectionné pour cette étude : la famille dans les années 1970 à 1990. Parmi les questions soulevées, celle de l’accessibilité des films de long-métrage composant le corpus traité, celle de la documentation autour de ces œuvres touchant notamment à l’analyse de leur réception à l’époque de leurs sorties, comme leur impact contemporain lors de rediffusions plus récentes. Pour illustrer ce propos, plusieurs exemples seront abordés tels que le film La Boum du réalisateur Claude Pinoteau (1980), sur lequel on trouve un nombre important d’écrits et de témoignages oraux ou encore, a contrario de ce premier exemple, un film largement moins documenté tel que Va voir maman, papa travaille du cinéaste François Leterrier (1978) qui nécessite alors un travail analytique s’appuyant sur la composition technique et esthétique de l’œuvre.
- L’escrime de guerre dans l’armée française, de la Révolution à la Première Guerre mondiale : pratique et théorie du corps à corps dans la guerre moderne,
par Ju Garry (Docteur en histoire contemporaine)
Il existe une tradition militaire aujourd’hui disparue, mais qui fut longtemps intrinsèquement liée aux pratiques de guerre moderne en Occident, et particulièrement en France : l’enseignement, l’étude, la pratique et la stratégie du corps à corps à l’arme blanche, pour l’infanterie comme pour la cavalerie. Réduite en Art tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, cette façon de combattre oscille entre science gestuelle précise et mortelle, sujet de réflexion stratégique sur l’avenir de la bataille, et critique d’une pratique dont l’image dépasse souvent la portée. Les nombreux textes techniques en français, laissés par les experts de l’escrime à la baïonnette, au sabre à pied ou au corps à corps à cheval, nous renseignent par leur présence comme par leur contenu sur un changement majeure qui s’opère au XIXe siècle : une métamorphose de ce qu’est le soldat français, et de ce qu’il doit savoir et savoir-faire. Les commentateurs de la pertinence, de l’avenir et du devenir de ces méthodes, quant à eux, nous instruisent sur les débats parfois houleux qui animent le monde de l’escrime de guerre, alors que cette pratique doit d’abord s’installer, et se normaliser, puis évoluer, et enfin, au crépuscule de la première guerre mondiale : disparaître. Haute en couleurs, rocambolesque et bercée d’imaginaire, portée par des personnages parfois pittoresques, l’escrime de guerre française n’est pas isolée : elle influence, construit et se construit autour de ses rivales européennes, chaque armée vantant les méritent de ses coups, ses bottes et ses parades, forcément supérieures à celles de ses ennemis… Cet apogée de la culture de l’escrime de guerre au XIXe siècle n’est autre que le baroud d’honneur d’une manière de combattre déjà agonisante, qui après plusieurs siècles d’un usage inégal tend à s’éteindre lentement, mais pas sans briller une dernière fois : le corps à corps dans la bataille.