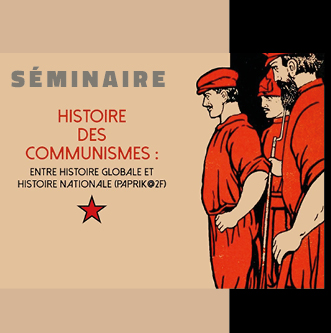Séminaire « Ateliers sur l’histoire du Communisme » (2025-2026)
Organisation : Louise Bur Palmieri, univ. Paris-1 Panthéon Sorbonne/CHS ; Marco Di Maggio, univ. Sapienza (Rome) ; Jean-Numa Ducange, univ. Rouen/GRHis ; Pierre-Henri Lagedamon, univ. Rouen/GRHis ; Elisa Marcobelli, univ. Rouen/GRHis ; Roger Martelli ; Guillaume Roubaud-Quashie, univ. Bourgogne Europe/LIR3S UMR 7366 CNRS-UBE ; Jean Vigreux, univ. Bourgogne Europe/LIR3S UMR 7366 CNRS-UBE ; Serge Wolikow, Bourgogne Europe/LIR3S UMR 7366 CNRS-UBE
Partenariat avec la MSH de Dijon, le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin (LIR3S) de l’Université Bourgogne Europe, le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS) de l’Université Paris 1, l’Universita Sapienza Roma et le Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis) de l’Université de Rouen.
Présentation du séminaire
Ce séminaire sur l’histoire du communisme se propose de traiter sous la forme de séances thématiques la question de l’insertion du PCF dans la société et le système politique français, dans la longue durée. Il a également l’ambition, dans le prolongement du programme Paprik@2F, de traiter l’articulation entre histoire globale et histoire nationale du communisme.
Calendrier des séances de la saison 2025/2026 [Programme provisoire]
- Une histoire mondiale des Fronts populaires. Introduction historiographique
26 septembre 2025, 14h-17h, MSH de Dijon – Université Bourgogne Europe (Dijon)
- Les Internationales ouvrières et l’enjeu du Front populaire
7 novembre 2025, Fondation Gabriel-Péri (Pantin)
- Les oubliées du Front populaire ?
12 décembre 2025, au Campus Condorcet
- Journée d’étude sur le Front populaire hors d’Europe
23 janvier 2026, au Campus Condorcet
- Le Front populaire à l’échelle locale : construire et consolider une assise communiste municipale et locale
6 février 2026, Fondation Gabriel-Péri (Pantin)
- Sociaux-démocrates, communistes et Front populaire en Autriche
10 avril 2026, Université de Rouen
Présentation de la séance
La dimension internationale du Front populaire est indissociable de la genèse et du développement de l’ensemble de l’épisode historique.
Il y a bien sûr le contexte historique international, caractérisé par la profonde crise du capitalisme mondial et qui touche la France à partir de 1931 et s’approfondit les années suivantes. Il y a également la catastrophe allemande marquée par l’arrivée au pouvoir en janvier 1933 de l’extrême droite grâce à la droite. Le choc consécutif à l’effondrement de la gauche allemande qui était le fleuron des Internationales socialiste et communiste provoque stupeur et sidération particulièrement dans la gauche du monde ouvrier et intellectuel en France.
Pour autant, s’il est important, le rôle des deux Internationales n’explique pas le Front populaire.
L’Internationale communiste après une année de tergiversations incite au front unique ouvrier puis accepte non sans réserve la proposition de Front populaire venue du PCF. Elle contribue en 1935, lors de son VIIe congrès, à universaliser ce mot d’ordre, mais émet des critiques contre les partis communistes qui vont jusqu’à envisager la participation gouvernementale. Si elle se rapproche de l’Internationale socialiste en 1935 pour envisager des actions communes contre le fascisme italien, cela ne débouche pas sur une entente et des actions effectives.
Au sein de l’Internationale ouvrière socialiste (IOS), nombreux sont les partis socialistes, notamment du nord de l’Europe qui sont hostiles à l’action commune avec les communistes. Au bout du compte l’IOS laisse carte blanche à la SFIO en France pour s’engager dans le Front populaire sans lui apporter un soutien explicite et pratique.
Pour autant les deux Internationales font écho au Front populaire en France tout en restant très liées à l’évolution de la situation diplomatique, en particulier lors de la guerre d’Espagne.
Intervenants
- Adeline Blaszkiewicz-Maison, maîtresse de conférences à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
- Serge Wolikow, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.
Animation: Roger Martelli, historien.